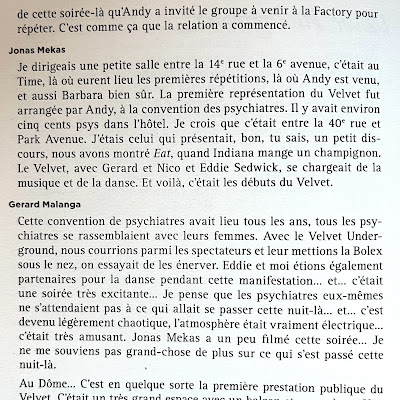Une amie, qui a écrit récemment un livre sur les descendants des déportés de la Shoah, raconte que concernant sa mère, elle s'avère incapable de mémoriser les dates (les dates de sa déportation et même l'année de sa mort il me semble, mais je n'ai pas réussi à remettre la main sur son livre dans ma bibliothèque pour vérifier cela), et qu'elle est obligée de s'en référer à un ouvrage qu'elle avait écrit précédemment la concernant pour retrouver ces informations.
J'ai le même problème avec mes amis morts du sida, alors que (mais c'est aussi la raison, le pourquoi) ces disparitions s'échelonnent sur un nombre restreint d'années, et dans ma tête je fais un peu comme s'ils étaient tous morts en 1995, ce qui est évidemment absurde.
Ces derniers temps, je me suis replongé dans des écrivains qui ont publié ces années-là sur ce thème-là (de Duve, Bourdin, Guibert etc.), me questionnant moi-même sur mon désir d'écrire à ce sujet, puis, cherchant des résonances à une forme de deuil impossible, j'ai pas mal lu d'ouvrages de personnes ayant perdu un enfant en bas âge (Philippe Forest, Laure Adler, Doan Bui etc.).
Finalement, je me suis retrouvé en train de relire le livre d'Anne, la mère de Fred (décorateur sous le nom Lou Goaco), qu'elle avait écrit pendant la courte maladie et la mort de celui-ci (j'en avais déjà parlé ici, dans un billet daté du 29 janvier 2011), qui entre assez mal dans les deux catégories précitées.
J'ai seulement pris conscience alors que cela faisait trente ans que Fred était mort. Il avait raté de peu son trente-sixième anniversaire (en avril), il est mort le 19 mars 1994.
Sur un autre réseau social, j'avais posté une photo de Michel Foucault le 25 juin. Il était mort le 25 juin 1984.
Ce qui m'a paru le plus singulier en me remémorant la mort de Fred, c'est la réactualisation des affects. Dans la relation passionnelle qui nous a liée pendant des années, c'est difficile de dire qui a gagné le match des moments merveilleux ou des moments horribles. Ce qui est sûr, c'est que j'excuse notre maladresse à tous les deux, au regard de notre âge de l'époque, des circonstances très singulières, et aussi, mais c'est un regard que j'ai eu plus tard, au regard du profil psychopathologie de Fred. Qu'allais-je faire dans cette galère ? c'est une question que je n'ai été capable de formuler que petit à petit, et chaque désinvestissement dans la relation était très cher payé. Mais je me suis aperçu que la violence de son entourage à mon égard (la façon dont ils ont nié mon existence) suscitait encore chez moi la même forme d'incompréhension que je ressens toujours devant l'expression du mal.
 |
| Fred et moi à Cannes. |
Après avoir cherché en vain le bouquin de cette amie dont je parlais en introduction, je me suis demandé où avais-je bien pu ranger les photos que j'ai conservées de Fred. J'ai une grande boîte en bois "mausolée", qui contient pas mal de photos d'amis morts, des Pierre, Marc, Jean-Marc, Jean-Luc, Daniel, Levon, Benny etc. Il y a bien quelques Polaroid de Fred là-dedans, mais ce sont des photos non montrables, classées X (est-ce vraiment leur place dans cette boite aux souvenirs ?). Faut vraiment que je mette de l'ordre dans tout cela. En tout cas traîne dans cette boîte sépulture un Polar de Fred et moi que je n'aime pas beaucoup, car mon allure me paraît vraiment trop moche. J'ai les cheveux qui commencent à pousser, et j'ai un très vilain débardeur, dont je devais être très fier à l'époque (oui, j'en étais très fier, on est alors à la fin des années 1980). La photo est prise à Cannes, Fred travaille sur le plateau d'un jeu de société que des amis à lui ont inventé.